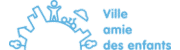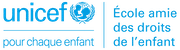Déclaration de Sheema Sen Gupta, Directrice de la protection de l’enfance à l’UNICEF, lors du débat public du Conseil de sécurité des Nations Unies intitulé « Les enfants et les conflits armés : stratégies efficaces pour mettre fin aux violations graves commises à l’encontre des enfants et pour les prévenir ».
New York, le 25 juin 2025 – « Excellences, distingués délégués, chers collègues, permettez-moi tout d’abord de remercier la Guyane d’avoir donné à l’UNICEF l’occasion de s’adresser aujourd’hui à ce Conseil. Alors que nous sommes réunis ici, je voudrais commencer par une vérité simple et douloureuse : le rapport du Secrétaire général cette année confirme une fois de plus ce que trop d’enfants savent déjà, à savoir que le monde ne parvient pas à les protéger contre les horreurs de la guerre.
Les Nations Unies ont recensé le plus grand nombre de violations graves commises à l’encontre d’enfants depuis le lancement de ce programme, soit une augmentation de 25 % par rapport à 2023, qui était déjà le chiffre le plus élevé jamais enregistré. Des milliers d’enfants tués et mutilés. Des milliers d’autres ont été recrutés, enlevés, violés ou privés d’aide humanitaire.
Et il ne s’agit là que des cas vérifiés. Nous savons tous que le nombre réel, l’ampleur réelle des dommages, est bien plus élevé. Chaque violation commise à l’encontre d’un enfant, dans tous les pays du monde, représente un échec moral. Et chacune laisse des cicatrices qui ne guériront jamais entièrement.
Derrière les chiffres, des vies d’enfants brisées
Excellences, derrière ces chiffres, il y a des noms, des visages et des vies. Au Soudan, une jeune fille de 14 ans a été violée par un groupe d’hommes dans sa propre maison. Sa mère a été menacée avec une arme pendant tout le viol et sommise à se taire.
Au Nigéria, six garçons âgés de 9 à 12 ans ont trouvé un objet métallique et l’ont apporté à un soudeur pour le vendre comme ferraille. L’engin a explosé alors que le soudeur l’examinait, le tuant sur le coup ainsi que les six garçons.
Cela se produit chaque jour à une échelle difficilement imaginable. En Israël et dans l’État de Palestine, plus de 8 000 violations graves ont été vérifiées l’année dernière. À Gaza, ce sont les enfants qui paient le plus lourd tribut. Nulle part ailleurs dans le monde un nombre aussi élevé de violations graves n’a été enregistré depuis que le Conseil a mis en place le mécanisme de surveillance et de communication il y a vingt ans.
Dans ce contexte, et au-delà, nous assistons à un effondrement des protections fondamentales dont chacun de ces enfants devrait bénéficier, non seulement en vertu du droit international, mais aussi en vertu de la dignité humaine.
Les armes explosives, première cause de mort d’enfants dans les conflits
Permettez-moi de souligner deux tendances profondément inquiétantes.
Premièrement, l’utilisation accrue d’armes explosives dans les zones peuplées. C’est aujourd’hui la principale cause de décès d’enfants dans de nombreux conflits à travers le monde, représentant plus de 70 % de tous les incidents ayant entraîné la mort ou la mutilation d’enfants. Ces armes détruisent les maisons, les écoles, les hôpitaux et les abris, même lorsque les familles s’y réfugient dans l’espoir d’être épargnées.
En République démocratique du Congo, à Gaza et au Myanmar, au Soudan, en Ukraine et au Liban, des enfants continuent d’être blessés ou tués non seulement dans des tirs croisés, mais aussi à la suite de campagnes de bombardements, de tirs d’obus et de restes explosifs de guerre.
Ces armes ne blessent pas seulement les enfants au moment de l’impact. La destruction des systèmes d’approvisionnement en eau, de l’électricité, des maisons, des hôpitaux, des écoles et des terrains de jeux a un impact direct sur l’accès des enfants à la santé, à l’éducation, à l’eau potable, à un endroit sûr pour jouer et dormir, c’est-à-dire aux fondements mêmes de l’enfance. Elles laissent derrière elles des munitions non explosées qui tueront et blesseront encore pendant des années.
Chaque obus non explosé laissé dans un champ, dans une cour d’école ou dans une ruelle est une condamnation à mort en attente d’être prononcée.
Les violences sexuelles se multiplient, l’impunité persiste
Le deuxième problème concerne la recrudescence des violences sexuelles. Les cas avérés de viols et autres formes de violences sexuelles contre des enfants ont augmenté de 35 % en 2024. Et il ne s’agit là que des cas vérifiés, alors que nous savons tous que ces violations sont largement sous-déclarées car les victimes, en particulier les enfants, craignent souvent la stigmatisation, la honte ou les représailles si elles osent parler.
Il ne s’agit pas seulement de « violations graves » au sens technique du terme. Ce sont des actes de brutalité qui détruisent des vies. Les survivants sont confrontés non seulement à des blessures physiques et à des traumatismes, mais aussi à la stigmatisation, au rejet et parfois à de nouvelles violences.
En République démocratique du Congo, au cours des deux premiers mois de 2025 seulement, près de 10 000 cas de viols et de violences sexuelles ont été signalés par des partenaires chargés de la protection de l’enfance. Plus de 40 % des personnes touchées étaient des enfants. En clair, pendant cette période, nous estimons qu’un enfant a été violé toutes les trente minutes.
Haïti est un autre exemple frappant, avec des centaines de cas enregistrés sur le territoire contrôlé par les groupes armés, souvent impliquant des viols collectifs.
En Somalie et au Mali, des situations similaires sont constatées, illustrant une évolution qui ne peut être qualifiée autrement que de défaillance systémique de la protection des enfants. Et pourtant, l’impunité reste la norme. Les survivants ont du mal à accéder aux soins et au soutien dont ils ont besoin. Les auteurs de ces crimes sont rarement tenus pour responsables. Nous devons changer cela.
Quand la volonté politique rend les progrès possibles
Excellences, ces faits sont accablants, mais ils ne reflètent pas toute la réalité. Car même dans un contexte de violence croissante et de ressources en baisse, le programme d’action en faveur des enfants et des conflits armés reste une source d’espoir.
En 2024, plus de 16 000 enfants ont quitté les forces et groupes armés et ont bénéficié d’une protection et d’un soutien à la réintégration, une chance pour ces enfants de se reconstruire un avenir. Et nous avons également constaté des progrès importants dans d’autres domaines :
- En Syrie, l’Armée nationale syrienne de l’opposition a signé un plan d’action visant à mettre fin et à prévenir le recrutement, l’utilisation, le meurtre et la mutilation d’enfants.
- En République centrafricaine, un protocole de transfert facilite désormais le transfert rapide des enfants des groupes armés vers des structures civiles.
- En Colombie, d’anciens commandants ont été inculpés pour crimes de guerre, notamment pour recrutement et violences sexuelles contre des enfants.
- En RDC, les enfants sont séparés des forces de sécurité nationales grâce à une évaluation de leur âge et à un examen mené par les Nations Unies.
- En Haïti, les autorités de transition ont créé une force opérationnelle conjointe chargée de mettre en œuvre les protocoles de transfert des enfants associés à des groupes armés.
- Et en Irak, au Pakistan, en Libye et aux Philippines, les gouvernements ont pris des engagements concrets pour mettre fin aux violations graves.
Ces exemples nous rappellent que lorsque la volonté politique existe, des progrès sont possibles. Ils soulignent également le rôle essentiel des acteurs humanitaires et de la protection de l’enfance, qui travaillent souvent au péril de leur vie.
L’UNICEF appelle le Conseil et les États membres à prendre des mesures urgentes dans six domaines clés :
- Premièrement, exiger de toutes les parties au conflit qu’elles respectent le droit international humanitaire et mettent fin aux violations graves. Cela implique notamment de signer et de mettre pleinement en œuvre les plans d’action établis avec les Nations Unies, de libérer les enfants enrôlés dans les forces armées et de les remettre aux autorités chargées de leur réintégration, de faire respecter les ordres clairs interdisant les violations et d’assurer la responsabilité de ces actes, de reconnaître les enfants comme des victimes et non comme des menaces, et de mettre fin à la détention d’enfants pour leur association présumée avec des groupes armés.
- Deuxièmement, mettre fin à l’utilisation et à la prolifération des armes explosives dans les zones peuplées. Cela implique d’approuver et de mettre en œuvre la Déclaration politique sur les armes explosives dans les zones peuplées, de suspendre les transferts de telles armes vers des parties connues pour prendre pour cible des civils, leurs habitations, leurs écoles et leurs hôpitaux, et de respecter le Traité sur l’interdiction des mines antipersonnel et la Convention sur les armes à sous-munitions. Nous ne pouvons pas permettre que les efforts visant à soutenir ces traités qui sauvent des vies soient réduits à néant.
- Troisièmement, protéger et étendre les espaces humanitaires. L’accès humanitaire est aujourd’hui plus restreint que jamais. En 2024, le nombre d’humanitaires tués, y compris des membres du personnel des Nations Unies, a atteint un niveau sans précédent. Cette situation est intolérable. L’aide doit pouvoir parvenir aux enfants où qu’ils se trouvent, en toute sécurité et sans entrave.
- Quatrièmement, soutenir et faciliter l’engagement humanitaire auprès des groupes armés non étatiques afin de renforcer la protection des enfants et de garantir l’accès à l’aide. Au fil des ans, cet engagement a porté ses fruits pour les enfants, en favorisant le respect du droit international et en permettant l’adoption de mesures immédiates et concrètes, notamment celle de plans d’action.
- Cinquièmement, financer ce programme. Les coupes budgétaires sévères compromettent notre capacité à surveiller, prévenir et réagir. Les programmes de réintégration sont réduits. Le soutien en matière de santé mentale est en train de disparaître. Les soins spécialisés et vitaux pour les survivants de violences sexuelles sont de plus en plus difficiles d’accès. Sans un financement adéquat et prévisible, le programme « Enfants et conflits armés » ne peut pas aboutir.
Enfin, tous les États ont le devoir non seulement de respecter le droit international humanitaire, mais aussi de veiller à ce que les autres le respectent également. Tout soutien – militaire, financier ou politique – apporté aux parties à un conflit doit être assorti d’attentes et de conditions claires en matière de protection des enfants.
L’urgence absolue est de protéger les enfants
Excellences, l’UNICEF est né des ruines de la guerre, créé pour venir en aide aux plus vulnérables, les enfants pris au piège des conflits. Cette mission n’a jamais été aussi urgente qu’aujourd’hui.
Les enfants ne sont pas des dommages collatéraux. Ils ne sont pas des soldats. Ils ne sont pas des monnaie d’échange. Ce sont des enfants. Ils méritent d’être en sécurité. Ils méritent justice. Ils méritent un avenir.
Ce Conseil a un rôle unique à jouer pour rendre cet avenir possible. Nous ne pouvons pas permettre que ces graves violations commises à l’encontre des enfants se poursuivent sans que rien ne soit fait. Cela ne peut pas devenir la nouvelle norme.
Agissons sans attendre. Agissons avec courage. Et surtout, agissons avec la conviction que chaque enfant, où qu’il se trouve, mérite de vivre en paix. »
Télécharger les contenus multimédias ICI.